Vous avez patienté pendant une trentaine de jours pour voir apparaître notre revue de presse UX #8 ? Elle va nourrir votre réflexion autour des sujets d’actualité : accessibilité numérique, IA et ergonomie cognitive, projets UX, designs systems.
Ce mois-ci, Ludotic vous a sélectionné les 3 articles, riches en exemples pratiques :
- Des questions à se poser avant le démarrage de nouveaux projets UX
- Des retours concrets sur l’accessibilité des design systems
- Les principes de l’IA pour la décharge cognitive des utilisateurs
1. Démarrer un nouveau projet UX : 3 questions pour commencer
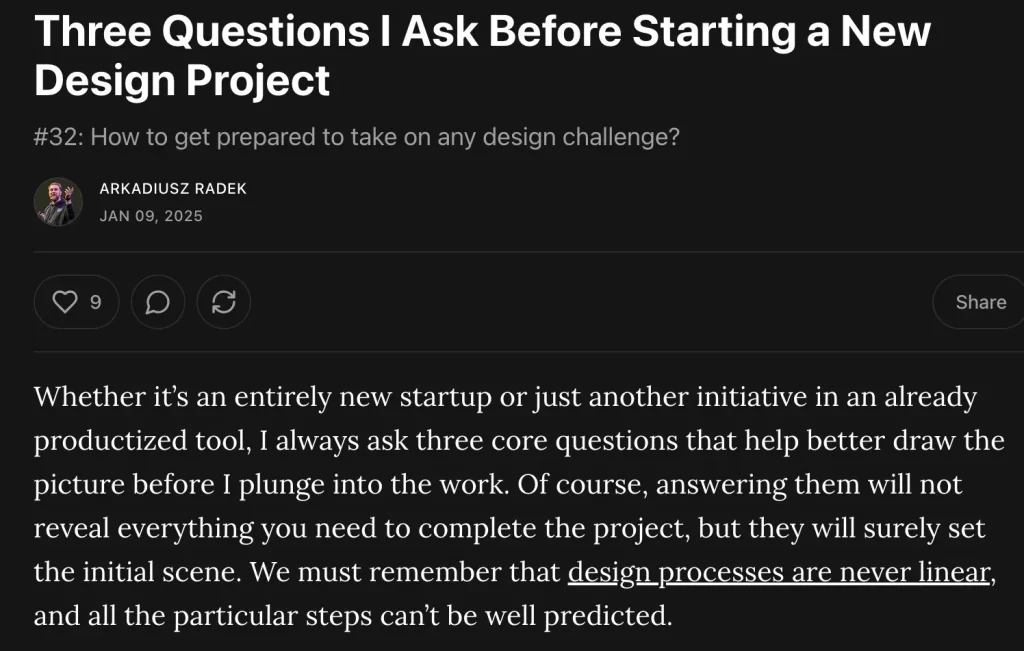
Pour débuter l’année, voici un article qui nous aide à sortir de l’éternel questionnement : par où commence-t-on dans un projet UX ?
Au lieu de se poser cette unique question, l’auteur nous guide avec 3 questions concrètes :
- Quels sont les indicateurs de réussite du nouveau projet ?
- Comment les utilisateurs bénéficieront de ce nouveau projet ?
- Qu’est-ce qui peut ne pas fonctionner et comment évaluer les potentiels risques ?
Ces 3 questions portent sur le compromis entre l’évaluation des risques et les gains potentiels. A travers les réponses, l’auteur cherche l’équilibre entre les besoins utilisateurs et les enjeux business dans un projet UX.
Dans la première partie, il explique la méthode en donnant des exemples. Ce que l’on aimerait retenir, c’est une liste d’affirmations pour énumérer vos indicateurs de réussite. Pour cela, prenez la même phrase et essayez de la continuer différemment : « le projet est considéré comme réussi si… ».
Pour répondre à la deuxième question concernant les utilisateurs, l’auteur nous propose de nouveau de nous armer de trois nouvelles questions :
- Les utilisateurs pourront-ils trouver utile ce que l’on est en train de créer ?
- Les utilisateurs vont-ils apprécier et utiliser ce nouvel outil ou nouvelle fonctionnalité ?
- Ce nouvel outil ou cette nouvelle fonctionnalité risque-t-il/elle de dégrader l’expérience utilisateur ?
Le dernier paragraphe nous explique comment identifier les risques. L’auteur cite 3 problèmes qui peuvent survenir lors des entretiens avec les parties prenantes. En effet, l’UX designer est amené à commencer par les interviews avec les parties prenantes pour mieux prévoir ces risques dans un projet UX.
Découvrez l’article Three questions I ask besofre Starting a new design project en anglais et en entier !
2. Accessibilité et design system : retours d’expérience sur 2024
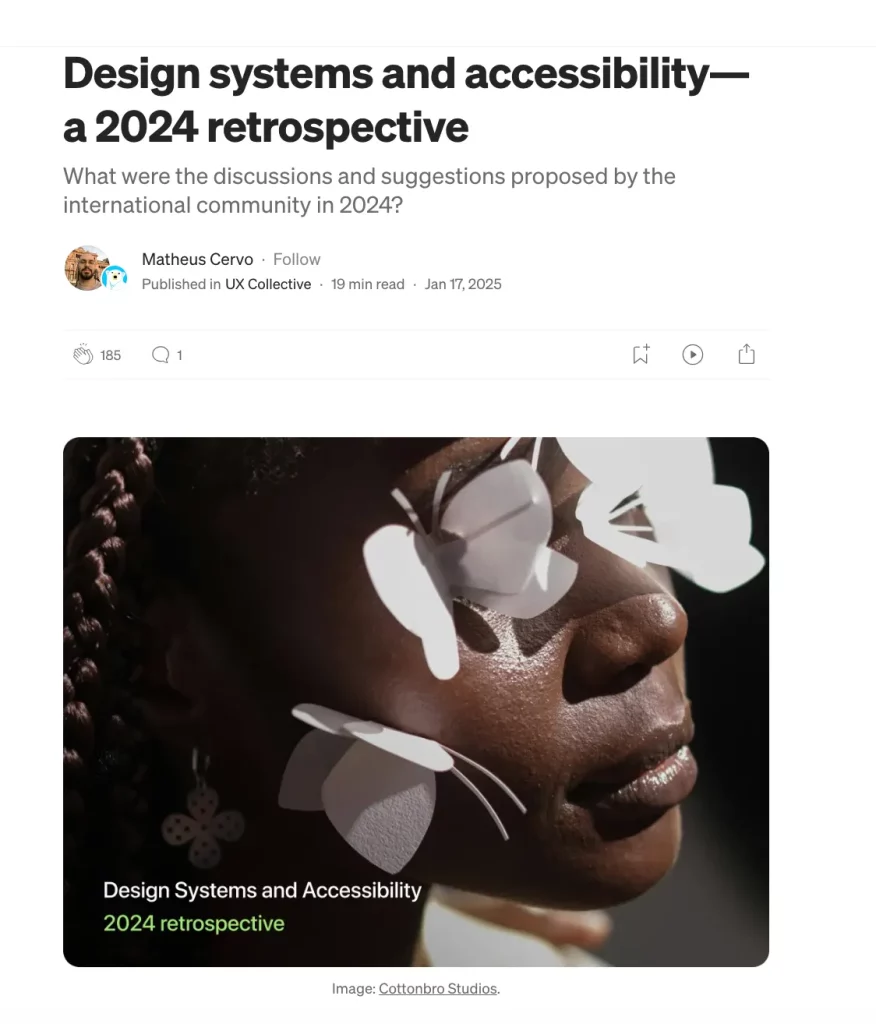
Une fois le projet UX démarré, la phase de maquettage est inévitable si l’on veut bien réussir le cycle de conception. Cette fois-ci, l’auteur du deuxième article nous propose de réfléchir autour des design systems accessibles :
- Que signifie vraiment l’accessibilité évolutive dans les design systems (DS) ?
- Comment rendre le DS accessible ?
L’article se compose de 7 sections :
- Méthodologie
- Pourquoi concevoir les DS accessibles ?
- Qu’est-ce que l’on entend par l’accessibilité des DS ?
- Comment faire évoluer un DS accessible ?
- Comment faire un test d’accessibilité d’un DS ?
- Comment organiser des tests d’accessibilité ?
- Comment documenter ces tests ?
La troisième section portant sur la définition de l’accessibilité des DS a retenu tout particulièrement notre attention.
Dans un DS, chaque composant doit répondre à une liste de critères techniques. C’est la base. Mais l’accessibilité du DS va au-delà de la simple conformité technique des composants. L’auteur parle de l’accessibilité des DS lorsque toute l’expérience dans son ensemble est prise en compte.
Par exemple, il cite l’importance de l’organisation des composants dans une interface. L’ordre réfléchi et respecté des composants facilite la navigation au clavier. En revanche, si cet ordre n’est pas respecté, l’interface risque de ne pas être accessible, même si tous les composants répondent individuellement à tous les critères d’accessibilité.
Un autre enseignement tiré en 2024, c’est la conception inclusive centrée sur l’utilisateur. Elle permet de répondre aux besoins réels et spécifiques des utilisateurs. Vérifier uniquement la conformité technique des composants sans les tests utilisateurs ne suffit pas.
Des exemples de design systems accessibles
Enfin, la section suivante de l’article nous a intéressés par ses nombreux exemples des DS accessibles. L’auteur cite l’exemple de BBC dans lequel l’approche Shift Left n’a pas vraiment fait ses preuves. Cette approche prône l’importance de la prise en compte de l’accessibilité le plus tôt dans un projet. Dans le cas de BBC, les composants testés et définis comme accessibles n’ont pas pu répondre aux défis d’accessibilité dans le nouveau contexte.
Pour conclure, l’auteur nous incite à bien définir la notion de l’accessibilité de nos DS pour ensuite la faire évoluer petit à petit pour ne pas la rendre rigide. En effet, l’impossibilité d’évolution rend l’accessibilité difficile au lieu de l’améliorer. Privilégiez donc une approche itérative et évolutive au lieu de viser une solution parfaite dès le départ.
L’article contient des propositions de documentations sur les tests d’accessibilité des DS bien détaillées. A la fin, vous avez accès aux multiples références sur le sujet.
Découvrez l’article sur les design systems en anglais ici !
3. IA et déchargement cognitif : partager le processus de réflexion avec les machines
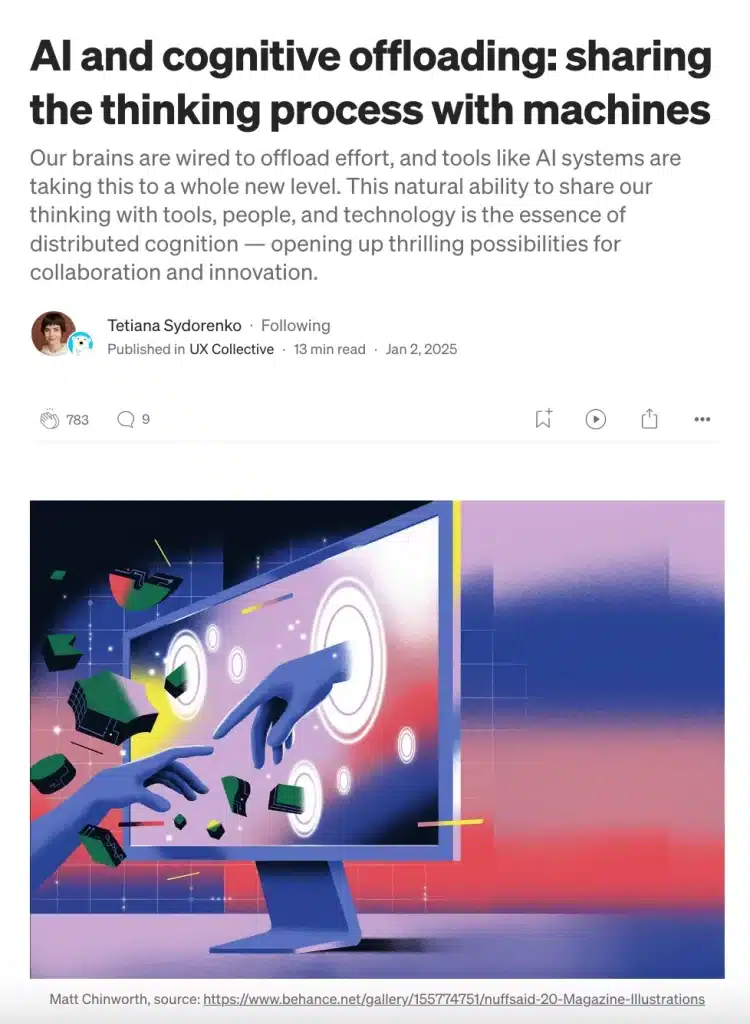
Enfin, la dernière publication traite de l’intelligence artificielle (IA) sous l’angle de l’ergonomie cognitive.
Voici le sommaire de l’article :
- Origines du concept de la cognition distribuée
- Le concept de la décharge cognitive
- Les 7 principes de création des applications IA basés sur la décharge cognitive
- Des réflexions finales
La notion clé atour de laquelle est construit ce dernier article est la cognition distribuée. C’est une approche systémique englobant à la fois des humains avec leurs pensées et la technologie.
En d’autres termes, Edwin Hutchins a introduit ce concept pour démontrer que la cognition ne se limite pas aux esprits individuels isolés mais se propage vers des interactions sociales et l’utilisation des outils. Pour en savoir plus sur ce concept, voici le lien vers son ouvrage « Cognition in the Wild ».
Sous l’angle de la cognition distribuée, l’autrice étudie les interactions entre les humains et les logiciels IA. Elle s’intéresse tout particulièrement aux principes des applications IA qui permettent à leurs utilisateurs de répondre à l’objectif principal : leur décharge cognitive. Autrement dit, comment décharger ses tâches mentales en utilisant les applications IA ? Tout cela dans le but d’améliorer nos capacités humaines à résoudre des problèmes.
Selon l’autrice, le concept sous-jacent de la décharge cognitive est central dans la création des applications IA. Elle nous explique en détail les 7 principes de ce concept qu’elle réunit en sections. Dans chaque section, nous avons des exemples concrets des logiciels IA qui sont basés sur ces principes. A la fin de chaque section, nous avons accès à une liste de ressources en ligne pour chaque principe abordé.
7 principes de décharge cognitive
Voici donc les 7 principes de décharge cognitive, utilisés par les concepteurs des applications IA les plus réussies :
- Comprendre les difficultés des utilisateurs. En particulier leur effort cognitif pour proposer un outil IA minimisant ce sentiment de l’effort. Exemple de Braintrust, une IA qui transforme des simples briefs humains en offres complètes pour aider l’utilisateur à créer des fiches de poste détaillées.
- Promouvoir la résolution collaborative des problèmes. Toujours dans l’optique d’alléger la charge mentale pour améliorer sa productivité. Exemple de Craft App, une IA qui propose des suggestions de rédaction dans une page blanche pour débloquer l’utilisateur quand il est à court d’idées.
- Utiliser les modèles et schémas mentaux existants. Toujours proposer des repères déjà connus pour l’utilisateur lors de la création de nouvelles fonctionnalités IA (aspects visuels et emplacement des boutons dans les interfaces IA).
- Tirer parti de la divulgation progressive. Révéler les informations au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Exemple de Airtable, un assistant IA qui guide les utilisateurs à travers les étapes découpées.
- Rebondir en douceur suite à un échec. Proposer des explications claires avec des suggestions ou des options de secours. Cela sert à maintenir la confiance et l’engagement des utilisateurs en cas d’erreurs. Exemple de la recherche Google basée sur l’IA pour fournir des corrections en cas de fautes des utilisateurs.
- Orientation contextuelle. Proposer des conseils en contexte au moment où les utilisateurs en ont besoin. Cela permet aux utilisateurs de rester concentrés sur leur tâche sans se noyer dans la quantité d’information. Exemple de June, une IA avec des exemples sur les types de questions à poser au moment où l’humain en a besoin pour réussir à explorer un nouveau système.
En conclusion, l’autrice rappelle l’importance de chercher le bon équilibre dans les systèmes de la cognition distribuée entre l’activité d’une personne et la décharge cognitive apportée par l’IA. Cela permet de garder sa juste place dans le monde des technologies actuelles.
Découvrez cet article bien détaillé et documenté sur l’IA et la décharge cognitive en cliquant ici.
Le mot de la fin
Nous espérons que la revue de presse #8 de ce mois de février vous a été utile. Si c’est le cas, nous vous invitons à attendre notre prochaine publication pour poursuivre votre activité de veille technologique mensuelle.
En attendant, n’hésitez pas à relire les revues de presse précédentes sur la page de notre blog. Elles sont toujours d’actualité.
Si vous avez besoin de notre expertise UX, découvrez tous nos services UX. Ils englobent également nos services en UX & Accessibilité, UX & Ecoconception et UX & Innovation dont le sujet de l’IA, abordé dans cette revue de presse.
Rendez-vous le premier mardi de mars pour notre prochaine revue de presse UX !

